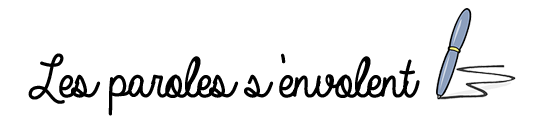RÉSUMÉ : les premières avocates
Les femmes ont prouvé leurs force avec la guerre de 1914, puis avec l’évolution du droit on a vu plaidé les premières avocates.
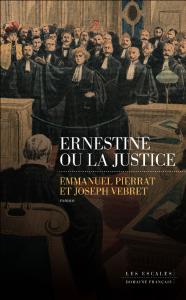
10/11/2021
246 p.
Paris. À la veille de la Première Guerre mondiale.
Le père d’Ernestine Godiveau réserve à sa fille un avenir respectable de femme au foyer. Dans cette conception traditionnelle de la famille bourgeoise, la femme se cantonne à s’occuper du foyer et des enfants.
À l’encontre des principes éducatifs qu’elle a reçus, Ernestine rêve de travailler pour s’affranchir de l’égide d’un mari. Elle ambitionne notamment d’étudier le droit et vise le métier d’avocate. Mais pour cela, elle doit pactiser avec son père qui accepte son inscription à la Faculté en échange d’un bon mariage avec Eugène. Optimiste, en attendant une intervention bénéfique du destin, elle supporte ce fiancé. Entretemps, elle fréquente en secret son amoureux Rodolphe, un jeune libraire dont elle partage un goût pour les écrits et la politique.
Pour finaliser sa quête de liberté et d’indépendance, Ernestine embrasse alors sa carrière d’avocate. En apprentissage chez maître Géraud, rencontré par l’entremise de Rodolphe elle prépare la défense de Raoul Villain. Devoir assister l’assassin de Jaurès un homme qu’elle et Rodolphe adulent se révèle un exercice de conscience pour expérimenter la profession.
MON AVIS
Ce roman historique aborde, par le biais d’une jeune femme, le déroulement de la Grande Guerre déclarée le lendemain de l’assassinat de Jean Jaurès. Cette mort a-t-elle précipité la guerre ? Le positionnement de ce pacifiste a-t-il échauffé l’esprit d’un « dérangé » ou d’un activiste politique ? Pourtant enclin à se battre, le pays va devoir s’adapter dans l’enlisement de cette guerre trop longue.
Le regard politique et la mentalité anti conventionnelle d’Ernestine expliquent le bouleversement qui va se produire dans la France durant la guerre. Et cette évolution passe par un changement du rôle des femmes. Jusque là, elles se montraient soumises sous un joug protecteur des hommes. L’adversité de la guerre a révélé des travailleuses dégourdies et capables de suppléer avec efficacité des hommes partis en guerre.
une avocate en 1914
La condition de la femme au début du XXe siècle est dépeinte par l’entremise de notre héroïne. Ici, la place des femmes dans la société s’apparente à celle d’un mineur. Ainsi, dépourvues de droits, célibataires ou mariées, elles se contentent de se taire et de se soumettre. La jeune fille passe de l’autorité du père à celle de son mari.
Le personnage d’Ernestine, jeune fille subversive pour l’époque, nourrit des idées d’émancipation. En effet, travailler pour acquérir une autonomie financière et une sociale est totalement contraire aux idéaux de sa classe sociale.
Alors, elle contrecarre les plans de son père, l’incarnation du réactionnaire. La jeune fille use de méthodologie, de psychologie ou d’hypocrisie pour qu’il accepte son émancipation. Ainsi, elle fuit les discussions frontales avec lui, car elle en connaît l’issue vu ses convictions irréversibles et l’approbation de sa mère.
Assassinat de Jaurès : Crime politique ou de droit commun ?
Mais une loi votée par Poincaré et Viadini accorde le droit aux femmes de devenir avocates.
Ainsi, le parcours d’Ernestine évoque celui de celles qui l’ont précédée, ou qui l’ont inspirée, comme Jeanne Chauvin, la première femme en France à avoir plaidé.
La préparation de la défense de l’assassin de Jaurès, Raoul Villain, est confiée à Ernestine. De là, elle va étudier les détails de son passé : de son environnement familial à sa vie d’étudiante décousue. D’ailleurs, aucune influence avec des groupuscules politiques mais la lecture des pressions médiatiques l’aurait poussé à commettre le crime. Donc, le jeune homme médiocre a agi seul et avec préméditation.
On assiste au procès de l’intérieur où l’évolution de la guerre marque la sévérité du jury. En effet, des reports de procès se sont succédés pendant plusieurs années. Sans clémence, Ernestine peaufine sa défense sans la moindre estime pour Raoul Villain. Heureusement, sa victoire professionnelle compense sa tristesse morale autour d’un verdict qui la sidère.
la guerre de 14
Loin des tranchées et des combats sanglants, Ernestine observe la guerre de Paris. Et le conflit va la débarrasser d’un fiancé encombrant tandis qu’elle vit sa romance avec Rodolphe.
Par ailleurs, le roman relate l’ensemble des publications à propos de l’entrée ou non de la France dans le conflit. En effet, d’une part le pacifiste Jaurès, un socialiste convaincu par la solidarité internationale, milite pour éviter une guerre sanglante. Et d’autre part, certains revanchards y voient enfin une opportunité pour récupérer des territoires perdus. Puis finalement, les événements politiques intérieurs et étrangers vont conduire le pays dans une guerre.
Une romance sur un fond historique et d’une recherche très renseignée.
Remerciements aux éditions les escales et le site internet Netgalley. #ErnestineoulaJustice #NetGalleyFrance
LES PLUS
Qui est 👉🧐 Jeanne Chauvin ? Qui est 👉🧐 Gaston Calmette ? Qui est 👉🧐 Henriette Caillaux ?
p. 229 : La guerre, non jamais, cela ne sert à rien, une machine à tuer, rien de plus… Mais le combat, c’est autre chose, il ne cesse jamais. Le combat pour la liberté, le respect de l’homme, de sa dignité… Au moins Jaurès n’est-il pas mort pour rien, il reste cela de lui, une foi en l’espérance humaine, la certitude que nous sommes tous capables du meilleur comme du pire ; c’est une question de choix et de volonté…
p. 230 : 1938 ⌈…] Cette année avait pourtant bien commencé, avec le vote en février de la loi instituant la fin de l’incapacité des femmes mariées. Elles n’étaient plus considérées par les textes comme incapables civiles. La lutte fut rude ; je m’y étais investie corps et âme. Après plus d’un siècle de subordination au mari, les femmes gagnaient enfin quelques libertés. Elles peuvent désormais, sans l’autorisation du mari, posséder une carte d’identité et un passeport, ouvrir un compte en banque, s’inscrire en faculté, passer un contrat pour leurs biens propres, accepter une donation, séjourner dans un hôpital ou une clinique sans être accusée d’abandon de domicile. Et surtout, elles ne doivent plus obéissance à leur époux. Mais il reste encore du chemin à parcourir, car le mari reste le chef de famille qui peut fixer le lieu de résidence, exerce l’autorité paternelle et peut s’opposer à ce que l’épouse exerce une profession.